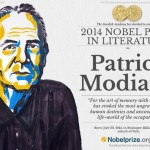Giorgia Alu, University of Sydney
La romancière italienne Elena Ferrante est une auteure culte. Le New York Times Book Review la décrit comme « l’un des plus grands auteurs de notre temps », The Economist dit qu’elle est « la meilleure romancière qui soit », et pour le supplément littéraire du Times, c’est « l’une des plus grandes romancières d’Italie » : les louanges pleuvent sans discontinuer.
Mais Elena Ferrante est aussi connue pour protéger farouchement sa véritable identité.
Napolitaine, féministe… et insaisissable
Que savons-nous d’elle ? Née à Naples, elle a étudié les lettres classiques. À l’âge de 13 ans, elle découvre les joies de l’écriture ; Elsa Morante est sa romancière préférée. D’origine modeste, Elena Ferrante ne vit pas de sa plume et exerce un autre métier (dont nous ne savons rien). Elle dit aussi que les théoriciennes du féminisme – Luce Irigaray, Adriana Cavarero, Donna Haraway, Judith Butler, Rosi Braidotti – ont influencé son travail. Son succès international ne se dément plus depuis que ses livres ont été traduits en anglais, en 2005. En France, seuls les deux premiers tomes de sa quadrilogie napolitaine ont été traduits pour le moment.
Mis à part ces quelques éléments, l’écrivain reste insaisissable. « Elena Ferrante » est le pseudonyme qui protège sa véritable identité depuis plus de 20 ans. Les rares indices sur la genèse de ses livres et ses méthodes de travail sont dispensés au compte-gouttes dans la presse écrite (dans The Paris Review, dans Vogue), ou dans la collection de lettres et de notes rassemblées dans son essai La Frantumaglia (2003).

Editions Gallimard
Elena Ferrante a publié son premier livre, L’amour harcelant, en 1992, suivi par Les jours de mon abandon (2002) et Poupée volée (2008). Dans une langue aussi charnelle que vivante, Ferrante nous plonge dans la vie complexe et passionnée de ses captivants personnages féminins : filles, mères, femmes abandonnées ou maltraitées, amantes, adolescentes, amies et écrivains. Ces femmes, opprimées par les hommes comme par le contexte social dans lequel elles évoluent, sont aussi des rebelles incontrôlables qui s’opposent aux modèles traditionnels de féminité.
Le « je » de Ferrante est toujours une femme (Leda, Delia, Olga ou Elena) et – a priori – ses livres s’inspirent d’expériences, de lieux et de personnages de son enfance.
Une saga d’amitié et d’amours, sans fioritures
C’est en 2011 que l’auteur lance sa très populaire quadrilogie napolitaine – L’amie prodigieuse (L’amica geniale, 2012), Le nouveau nom (Storia del nuovo cognome, 2013), Storia di chi fugge e di chi resta (2014) et enfin Storia della bambina perduta (2015). Ces livres racontent l’amitié dévorante entre Elena et Lila sur fond de bouleversements socio-économiques, des années 1950 à aujourd’hui (avec une attention particulière portée aux tensions sociales des années 1960 et 1970 en Italie).
Au fil des 1 700 pages de cette saga, nous suivons Elena et Lila de leur adolescence dans un quartier chaud et pauvre de Naples jusqu’aux années de leurs premières amours, en passant par leurs mariages décevants et leur vie professionnelle compliquée.
Leur amitié indéfectible, intense et mystérieuse, résistera aux désillusions, aux trahisons et à même à la maladie mentale.
Les romans de Ferrante transportent le lecteur par leur prose à la fois fluide, lucide et maîtrisée, sans fioritures inutiles – fioritures dont les auteurs italiens contemporains ont souvent tendance à abuser.
Les trois premiers volumes de la saga napolitaine se sont vendus à 130 000 exemplaires aux États-Unis comme en Italie, où les critiques sont élogieuses. Cependant, c’est à l’étranger que l’auteure est la plus populaire : publiée par Europa Editions à New York (propriété d’Edizioni E/0, sa maison d’édition italienne), elle est distribuée par Text Publishing en Australie. En France, c’est Gallimard qui a publié les deux premiers volumes de la saga.
Des romans populaires bâtis sur des émotions vraies
Pourquoi ses livres marchent-ils si bien ? Peut-être parce que ses romans tiennent à la fois du feuilleton, de la tragédie grecque, de l’opéra, du café-théâtre napolitain (« sceneggiata napoletana ») et du thriller. En prime, les personnages, les lieux et les situations que l’écrivain dépeint correspondent à une certaine vision – un peu cliché – de l’Italie : tout y est tapageur, théâtral et pittoresque.

Editions Gallimard
C’est Naples, cité sombre et chaotique indissociable du Vésuve, qui sert de toile de fond à des intrigues criminelles, à des histoires d’amour, de trahison et de jalousie et à des scènes de sexe très crues (qui rappelent parfois la série Les Soprano).
Tous les éléments narratifs s’emboîtent habilement, dans le style codifié du « romanzo popolare », le roman populaire, tel que le décrivait Umberto Eco.
Mais les livres de Ferrante ont quelque chose de plus : leur aura tient à la façon sincère et simple dont l’auteur sait transcrire les émotions. Le lecteur se sent submergé par les passions violentes, les obsessions et les illusions de ses fragiles protagonistes. Dans leur exploration du psychisme féminin, ces histoires parviennent à exprimer des émotions que tout lecteur – et surtout toute lectrice – a déjà éprouvées (en amitié ou dans ses relations familiales) mais qui sont difficiles à identifier et semblent indicibles.
Évidemment, le mystère qui entoure l’auteur accroît la fascination et l’intérêt des lecteurs pour ses romans. Elena Ferrante est-elle en réalité une femme, un homme, plusieurs personnes ou même un simple coup marketing ? Quelle que soit l’identité de l’écrivain, il ne fait aucun doute que son « absence » contribue à la popularité de ses écrits.
Un beau jeu de cache-cache
Ferrante préfère que ses livres vivent par et pour eux-mêmes : l’exposition médiatique et le statut d’auteur à succès peuvent en effet se révéler lourds à porter. Son « invisibilité » lui permet aussi d’écrire avec plus de sincérité, plus de profondeur, et de prendre plus de risques. Elle se refuse à l’exercice de la promotion, qui, selon elle, galvaude toute œuvre d’art. Le flou qu’elle entretient autour de son identité ouvre un espace créatif qui profite aussi à ses fidèles lecteurs, ainsi débarrassés de toute interférence entre eux et le texte, et qui se sentent, de ce fait, plus proches des protagonistes.
Les livres de Ferrante laissent le soin au lecteur de donner le sens qu’ils veulent à l’« espace multidimensionnel » du texte, comme le nommait Roland Barthes dans La mort de l’auteur en 1968. Un espace rempli d’une foule de sources préexistantes (textes divers, histoires, idées, souvenirs). Dans L’amie prodigieuse, Lila dit à Elena qu’il y a toujours un « avant ». Quand elle observe la façon dont son quartier, dans la banlieue de Naples, s’est transformé au fil du temps, elle dit
« Chaque pierre, chaque bout de bois, absolument tout était là avant nous, mais nous avions grandi sans nous en rendre compte, sans même y penser. »
Dans un constant jeu de cache-cache, il incombe alors au lecteur de découvrir et d’imaginer cet « avant » qui contient Ferrante elle-même, à la fois présente et absente.
Giorgia Alu, Senior Lecturer, Department of Italian Studies, University of Sydney
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.