
On ne peut que saluer l’attribution du Prix Nobel de littérature à Patrick Modiano. Avec l’écrivain, c’est une certaine image de la littérature française qui est pleinement reconnue à l’international. Ce Prix est le meilleur démenti apporté à tous les déclinologues de profession qui affirment que la littérature est en péril, le roman en coma dépassé, qu’il n’est plus de «grands écrivains», que «la culture française» est morte, pour reprendre la une d’un numéro du Times Magazine en date de 2007….
Loin d’être l’arbre qui cache l’absence de forêt, Modiano compte parmi ceux qui en éclairent les sentes. Il incarne une littérature tout à la fois profonde et accessible, qui ne dissocie pas travail de fond et souci de la forme, imagination sensible et vision du monde, art de raconter des histoires et nécessité de questionner l’Histoire – celle même qui s’écrit, selon Perec, avec sa grande hache.
On peut évidemment s’étonner que le Prix revienne à un auteur «so frenchy», dont les romans se déroulent pour l’essentiel à Paris et excellent à reconstituer avec un sens compulsif du détail toute une archéologie de la France révolue (les années 1930 à 1980). L’attribution du Nobel recouvre souvent un geste politique, au sens large, au sens «citoyen-vagabond» du monde. Le choix de Modiano se tient dans son œuvre. Si elle s’écrit au plus près d’un pays, la France, c’est que ce dernier constitue tout sauf une évidence pour les personnages de Modiano, des fugueurs, des apatrides, des persécutés migrateurs qui semblent décliner depuis le premier roman, La Place de l’étoile (1968), les mille et un visages d’une même figure de légende, le juif errant. L’œuvre se tient aux portes de l’Histoire.
Il faut se souvenir du premier Modiano, le jeune trublion des Lettres qui, avec un sens de la provocation hérité des Hussards, fait irruption sur la scène littéraire en 1968, renvoyant au pays l’image de ses propres refoulés historiques: la Collaboration, l’antisémitisme, qu’on évite plus qu’on ne les évoque dans ces années-là. Loin du consensus gaullo-communiste qui alors a valeur de vérité officielle – une France dans son ensemble résistante -, Modiano fait revivre tantôt dans ses trois premiers romans, tantôt au cinéma, en partenariat avec Louis Malle, l’époque de l’Occupation dont il reconstitue avec une précision hallucinée l’atmosphère délétère (Lacombe Lucien, 1974).
Né en 1945 d’un père juif trafiquant de marché noir, il s’éprouve comme l’enfant des décombres, le fils d’une époque-monstre.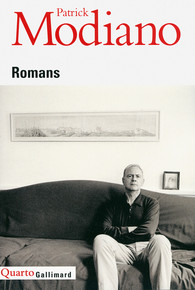 Son œuvre effectue la conversion d’une situation historique en un état de conscience symbolique. Si après 1945 le pays n’est plus occupé, sa mémoire, elle, le demeure aussi longtemps qu’il refuse d’admettre sa compromission avec l’occupant nazi et refoule la conscience de ses crimes. Chaque roman renvoie ainsi à cette double occupation, l’une liée à l’Histoire effective, l’autre à la mémoire impossible (Villa Triste, 1975, Rue des Boutiques obscures, 1978, Vestiaire de l’enfance, 1989, Du plus loin de l’oubli, 1996, dont le titre tient à lui seul lieu de programme). Mais la France des Trente Glorieuses, puis de Mai 68, puis de l’entrée dans la crise, n’a que faire de celle de Vichy.
Son œuvre effectue la conversion d’une situation historique en un état de conscience symbolique. Si après 1945 le pays n’est plus occupé, sa mémoire, elle, le demeure aussi longtemps qu’il refuse d’admettre sa compromission avec l’occupant nazi et refoule la conscience de ses crimes. Chaque roman renvoie ainsi à cette double occupation, l’une liée à l’Histoire effective, l’autre à la mémoire impossible (Villa Triste, 1975, Rue des Boutiques obscures, 1978, Vestiaire de l’enfance, 1989, Du plus loin de l’oubli, 1996, dont le titre tient à lui seul lieu de programme). Mais la France des Trente Glorieuses, puis de Mai 68, puis de l’entrée dans la crise, n’a que faire de celle de Vichy.
Il faut attendre la dernière décennie du vingtième siècle, ou le temps de tous les bilans, pour que les années 40 ressurgissent au premier plan de la vie littéraire, dans bon nombre de romans. En 1995, un Président de la République Française nouvellement élu reconnaît officiellement pour la première fois les exactions de l’État français et la responsabilité du gouvernement de Vichy dans les crimes de la déportation. Entre temps Modiano a continué son long travail d’exhumation de la mémoire collective. Son œuvre est entrée en résonance avec les travaux des historiens oeuvrant sur cette époque: Robert Paxton dans le milieu des années 1970, Henry Rousso à la fin des années 1980, Serge Klarsfeld dans les années 1990, lorsque l’écrivain publie Dora Bruder (1997). Cette œuvre elle-même a sensiblement évolué: à la verve iconoclaste et l’outrance expressionniste des premiers romans a succédé une écriture suggestive, comme en retrait de son propre sens, qui joue des ressources de l’ellipse et du non-dit, du ressassement et de l’inachèvement, pour frayer au plus profond des zones obscures de la vie psychique.
On a souvent dit de Modiano qu’il écrivait toujours la même histoire. C’est que son thème de prédilection, son objet d’exploration demeurent la mémoire. Celle-ci, on le sait, ne cesse de se travailler elle-même: elle occulte les souvenirs, les amalgame, parfois les laisse ressurgir, jamais figés, indéfiniment mobiles, au hasard de rencontres ou de sensations éprouvées à distance. La mémoire n’est pas un lieu de stockage sécurisé, mais une centrale éruptive: ce phénomène quelque peu déstabilisant, Modiano ne cesse, après d’autres, de l’appréhender.
Dans ses romans, les souvenirs sont toujours les signes d’une énigme qui renvoie la personnalité à ses incertitudes. L’œuvre s’écrit en cela comme une ronde inquiète. La Petite Bijou (2001) reprend les éléments d’une intrigue énoncée vingt ans plus tôt dans De si braves garçons (1982), Un cirque passe (1992) se retrouve en version miniature dans Accident nocturne (2003), un chapitre de Rue des boutiques obscures (1978) concentre une histoire déployée dans Remise de peine (1988), récit dont certains éléments traversent Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (2014), titre rappelant lui-même celui d’un roman antérieur, Quartier perdu (1984)…
Modiano ourdit ainsi une véritable toile autofictionnelle dans laquelle les éléments biographiques les plus intimes – une mère distante, un père absent, un frère disparu, une enfance ballotée, une adolescence à la dérive – se recomposent sans cesse, se vident de leur contenu élémentaire et se rechargent d’un autre sens, en recherche d’une vérité fatalement insaisissable. Par ce système de retours, Modiano crypte discrètement ses récits, dans une ligne narrative et syntaxique minimale propre à figurer des états de conscience indécis, un rapport troublé à la vie et la nécessité de devoir s’élucider sans cesse soi-même.
À la longue, l’écrivain confère ainsi une structure mythologique à la plus universelle des situations: l’être en prise avec son propre inconscient. La perspective historique recouvre en cela un sens romanesque de la variation ontologique. Ce que l’on appelle la petite musique de Modiano, c’est l’art sensible de suggérer par le rythme et les sons, par le phrasé, ce qui ne peut être identifié de façon rationnelle, ce qui demeure innommable et se communique par le seul partage de l’émotion: une vie subliminale, faite d’anxiétés primitives et de traumatismes enfouis, qui traversent les générations, alimentent les cauchemars des enfants et, parfois, l’imaginaire des écrivains. Un travail d’artiste, qui inscrit Modiano dans la lignée d’un Proust et le voisinage d’une Duras. Ce Nobel est aussi un peu le leur – et celui de Perec.
Mais le coup de génie de Modiano, c’est peut-être de réussir à nous placer, nous lecteurs, en situation d’amnésie sitôt achevé le livre, évanoui le charme du récit. Que nous a-t-on raconté au juste? Qu’est-ce qui chemine en nous sans que nous puissions vraiment le formuler, vraiment l’objectiver, par delà une intrigue qui s’est comme auto-effacée de notre mémoire au fur et à mesure que nous la lisions? Cette puissance d’une littérature qui ne se paie pas de mots mais laisse des traces, éprouve l’Histoire et l’être au monde, c’est ce qui signe une œuvre majeure. Celle de Modiano, l’un de nos contemporains capitaux.
Bruno Blanckeman, universitaire, critique et essayiste français, né à Paris au début des années 1960, est professeur de littérature française des xxe et xxie siècles à l’Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3
Il anime le CERACC, Champ d’Etude du Récit Actuel et Contemporain (UMR THALIM).
Il est l’auteur de l’essai Lire Patrick Modiano (Armand Colin, 2009)



